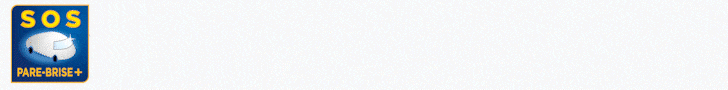La comparution immédiate permet de faire juger immédiatement les personnes poursuivies pour certains délits. De plus en plus utilisée, cette procédure fait l’objet de nombreuses critiques : droits de la défense moindres, surreprésentation de personnes précaires, nombreux recours à la détention provisoire…
La comparution immédiate est une procédure prévue par le code de procédure pénale qui permet de faire juger un prévenu, sous certaines conditions, dès la fin de sa garde à vue. C’est le tribunal correctionnel, chargé de la répression des délits, qui juge les personnes acceptant cette procédure.
La comparution immédiate consiste en une succession d’étapes dans un temps très restreint, qui se compte en jours. Cette procédure permet de juger des infractions qui peuvent mener jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (voire 20 ans dans le cas de délits commis en état de récidive).
L’origine de la comparution immédiate
La possibilité de faire comparaître un prévenu devant le juge le jour-même existe depuis 1863 pour certains délits, par le biais d’une première procédure qui limitait l’instruction à un interrogatoire, mené immédiatement après l’arrestation. Le procès pouvait ainsi se tenir dans les jours suivants, permettant un traitement rapide des affaires.
La loi du 20 mai 1863 sur l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels limitait dans un premier temps cette procédure accélérée aux flagrants délits – lorsque la personne est prise sur le fait – punis d’une peine d’emprisonnement. La loi du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes l’avait ensuite étendue aux délits non flagrants, lorsqu’ils étaient punis de moins de cinq ans de prison.
Finalement, une loi du 10 juin 1983 a instauré une procédure unique de comparution immédiate, qui s’applique toujours aujourd’hui – avec quelques modifications depuis sa création. La procédure de comparution immédiate est régie par les articles 395 à 397-1 du code de procédure pénale.
La comparution immédiate constitue une exception au temps habituel de la justice. Elle est louée par certains pour sa rapidité, dans un contexte où la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour violation du droit à un délai raisonnable de jugement. Néanmoins, une étude récemment publiée par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté alerte sur le risque d’une « justice expéditive« .
Les conditions requises
La mise en œuvre de la comparution immédiate est soumise à plusieurs conditions :
- les éléments de l’affaire doivent justifier le déclenchement d’une telle procédure ;
- l’affaire doit être en état d’être jugée (une enquête approfondie n’est pas nécessaire) ;
- les charges réunies doivent être suffisantes.
Ces éléments sont à l’appréciation du Procureur de la République, qui relève du parquet.
Les autres procédures de comparution
Si le Procureur de la République estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée (attente de résultats de réquisitions ou d’examens sollicités), il ne peut mettre en œuvre une comparution immédiate. Dans ce cas, il peut recourir à une comparution à délai différé, créée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice afin d’accélérer la procédure dans les cas où la comparution immédiate est impossible. Le prévenu est alors jugé dans un délai de 2 mois après sa garde à vue.
Une autre procédure permettant de juger rapidement existe depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), ou « plaider-coupable ». Elle est réservée aux auteurs de délits reconnaissant leur culpabilité.
La comparution immédiate ne peut être mise en place que pour certains délits (et jamais pour les contraventions, ni les crimes) :
- ceux punis d’au moins 2 ans de prison ;
- ceux, flagrants, punis d’au moins 6 mois de prison.
Certains délits ne peuvent être jugés dans le cadre d’une comparution immédiate : c’est le cas de plusieurs délits de presse et des délits politiques.
Enfin, seules les personnes majeures peuvent être jugées en comparution immédiate. Néanmoins, une proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents prévoit d’étendre cette possibilité aux mineurs de plus de 16 ans, sous certaines conditions. Dans un avis du 21 novembre 2024, la Défenseure des droits a considéré que cette réforme contreviendrait au principe fondamental d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.
Le déroulé de la procédure
La comparution immédiate se déroule dans un temps très restreint.
À la fin de sa garde à vue, le mis en cause peut être déféré devant le Procureur de la République (article 803-2 du code de procédure pénale). Cette mesure de contrainte doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue, ou au maximum dans les 24 heures suivantes – sauf pour les gardes à vue ayant duré plus de 72 heures. Si ces délais ne sont pas respectés, le mis en cause doit immédiatement être remis en liberté.
La personne déférée est auditionnée et informée de ses droits et des faits qui lui sont reprochés. Le mis en cause et son avocat, le cas échéant, ont le droit de présenter leurs observations. C’est lors de cette procédure de défèrement qu’un jugement en comparution immédiate peut être décidé. La date et l’heure de l’audience sont communiquées au prévenu, sachant qu’il lui est possible de refuser d’être jugé dans le cadre d’une comparution immédiate. Pour que le consentement du prévenu à être jugé via cette procédure soit valable, la présence d’un avocat est obligatoire.
Jusqu’à son audience de comparution, le prévenu est retenu. Il fait l’objet d’une enquête sociale rapide (ESR), un entretien visant à vérifier sa « situation matérielle, familiale et sociale » et à envisager les peines qui pourraient être prononcées (article 41 du code de procédure pénale). Cet entretien, souvent mené par des associations habilitées, dure généralement quelques dizaines de minutes.
En principe, la comparution doit avoir lieu le jour-même de la décision d’y recourir. Si ce n’est pas possible, l’audience peut être reportée jusqu’à trois jours ouvrables maximum. Dans ce cas, en attendant l’audience, le Procureur peut demander au juge des libertés et de la détention (JLD) de placer le prévenu en détention provisoire, de le soumettre à un contrôle judiciaire ou de l’assigner à résidence avec surveillance électronique.
Le jour de l’audience, le prévenu est présenté sous escorte devant le tribunal correctionnel. L’audience en comparution immédiate se déroule de la même manière qu’une audience « classique », sachant que le prévenu peut à nouveau refuser d’être jugé sur-le-champ, auquel cas une nouvelle audience est fixée entre 4 et 10 semaines plus tard. Jusqu’à cette audience, le JLD peut à nouveau décider d’un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, ou d’une assignation à résidence.
Une procédure courante et critiquée
La comparution immédiate est de plus en plus utilisée : le recours à cette procédure a quasiment doublé depuis le début des années 2000, passant de 31 213 en 2001 à 60 348 en 2023 (Source : Chiffres-clés de la Justice, Site du Ministère de la Justice).
Or, cette procédure fait l’objet de plusieurs critiques, notamment concernant les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Le temps dédié à la préparation de la défense est extrêmement restreint, ce qui peut affecter sa qualité. La durée des audiences est également plus courte que celle des audiences « classiques », ce qui limite la possibilité pour les juges de prendre du recul sur l’affaire. Les magistrats enchaînent de nombreuses audiences, et donc de nombreuses décisions, à un rythme très soutenu.
Cette procédure est particulièrement utilisée à l’encontre de certaines catégories de la population : les personnes jugées dans le cadre d’une comparution immédiate sont principalement des hommes jeunes et peu insérés (nombre d’entre eux sont sans logement et sans emploi), avec une part importante de personnes étrangères. L’étude sur la comparution immédiate publiée par le CGLPL critique à ce sujet la « surreprésentation de populations marginalisées et fragilisées« .
Le nombre de placements en détention provisoire décidés dans le cadre d’une comparution immédiate est critiqué par plusieurs acteurs des domaines pénal et carcéral. La première source de placement en détention provisoire est la comparution immédiate. En 2019, près de la moitié de l’ensemble des personnes placées en détention provisoire l’étaient dans le cadre d’une comparution immédiate – composant plus de 37% de l’ensemble des placements en détention (prévenus comme condamnés), sur cette même année (Source : Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, N° 50, Site du Ministère de la Justice). Une part non négligeable de la population incarcérée l’est donc alors qu’elle n’a pas encore été condamnée – et est donc présumée innocente.
Le placement en détention provisoire est pourtant censé être exceptionnel : il n’est possible que s’il est considéré comme constituant l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs fixés par l’article 144 du code de procédure pénale (conserver des preuves et indices, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes…). De plus, au-delà de la privation temporaire de liberté, le fait d’avoir été placé en détention provisoire a un impact sur la peine finalement prononcée. Plusieurs études, citées par le CGLPL, montrent que le fait d’avoir été placé en détention provisoire augmente le risque d’être condamné à un emprisonnement ferme.
Plus largement, la Contrôleure recommandait dans un avis du 25 juillet 2023 « une baisse du recours à des procédures accélérées telles que la comparution immédiate, principales pourvoyeuses d’incarcération et en particulier de courtes peines« .
Source: vie-publique.fr